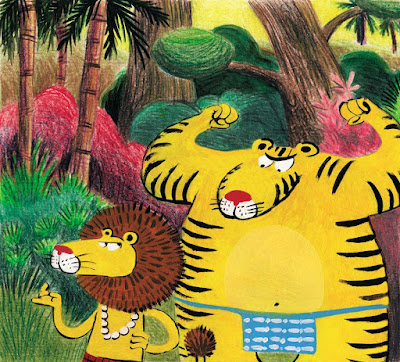Quand la brillante
Clémentine se penche sur notre petite psyché d’auteur jeunesse, cela donne sa
tribune pour la Charte où elle pointe la double injonction schizophrénique pesant sur notre profession, à savoir les deux mythes contradictoires qui font de nous des sous-littéraires tout en sacralisant notre public. Cela donne aussi
son premier billet sur les passions de l’âme et le délicat problème de l’identité, à la fois intime et publique. Comme tout cela fait pile écho à ma crise existentielle du moment, j’ai envie de prendre le train en marche et de m’interroger aussi sur ce qui pique dans ce moi-écrivain jeunesse.

Pour aujourd’hui je voudrais revenir sur une confusion qui a été faite sur un de mes propos où je déclarais ne pas me reconnaître comme écrivain. Le mot est tellement lourd dans notre langue, qu’il a donné lieu à des tas de considérations esthético-éthiques, alors que mon intention était de pointer un trou lexicologique. En effet, dans la mesure où je suis essentiellement auteur d’albums, et que l’album est un objet intermédial où l’image, voire la mise en page et les choix liés à l’objet-livre, tiennent un rôle extrêmement important, il me semble que le mot écrivain est peu approprié. D’autres genres à la croisée des arts ont réussi à imposer leur mot : on parle de scénaristes en BD, de paroliers en musique, de dramaturges en théâtre… Aucun de ces trois métiers ne se satisferait du mot d’écrivain sans que l’on songe pour autant à nier le caractère artistique de leur activité.
Or, peut-on habiter un métier s’il n’a pas de mot pour le caractériser ? Comment se situer quand il faut user d’une périphrase pour expliquer ce que l’on fait ? Une fois sur deux quand je dis que j’écris des albums pour enfants, on me demande si j’illustre aussi. Non « juste » les mots. Je vois bien que les gens sont un peu déçus et ne situent pas trop mon rôle, tout pétris qu’ils sont des histoires transparentes qui alimentent la partie la plus visible de l’édition jeunesse. En ce sens, les polémiques du type Copé ont du bon, le grand public prend tout à coup conscience que la littérature jeunesse ne consiste pas qu’en des histoires de lapins ou de pots.
La question rejoint d’ailleurs celle de la dénomination d’auteur jeunesse… Souvent, la solution réclamée par les collègues est de s’affirmer « auteur tout court », ou justement « écrivain ». Mais je ne suis perso pas trop pour… Je n’ai pas envie de cacher le « jeunesse » en le glissant sous le tapis. Je suis personnellement heureuse et fière d’écrire pour ce public-là. Je le prends pour une spécialité, comme peut l'être la pédiatrie à la médecine, et je ressors dès que l'occasion s'en présente la posture de Tournier : « parfois j'écris si bien que ce j'ai écrit peut être lu par les enfants ». Mais c'est encore trop simple et le public "jeunesse" lui-même ne relève pas de l'évidence.
Ce sont en effet des adultes qui achètent nos livres et ce sont eux qui les lisent, dans le cas d'albums en tout cas. La question est sans doute différente pour les adolescents, mais pour les petits, sauf cas particuliers, nos livres auront de toute façon besoin d’un médiateur. J’ai écrit plusieurs livres en songeant à ma frangine institutrice (pardon « professeur des écoles » - m’est avis que par là-bas aussi il y a des soucis d’identité ;-) et j’essaye de faire en sorte, que les adultes prennent plaisir à les lire, en leur glissant des clins d’œil qui leur sont réservés. Mais si écrire pour les enfants est sous-estimé, écrire pour les parents est carrément tabou. On met les deux pieds dans le caractère « fonctionnel » de l’écriture, sans même bénéficier du côté mystique du petit-nenfant-aux-yeux-plein-de-nétoiles.
Une mystique qui est même en général construite contre l'adulte, que l'on caricature volontiers en philistin obtus que notre livre vient contrer, situation d'autant plus paradoxale que les adultes qui gravitent dans l'univers du livre jeunesse (salons, instits, etc.) sont justement des adultes sensibilisés à la question. Mais de toute façon, l’appellation « auteur (mais juste les mots) d’albums pour adultes sensibilisés les lisant à des enfants » commence à faire un peu longs sur la carte de visite. Bref, c’est pas la solution.
Il y a en tout cas, avec le souci d’identité, un vrai souci d’identification.
Merci
Clémentine d’avoir mis le doigt là où ça fait mal :-)